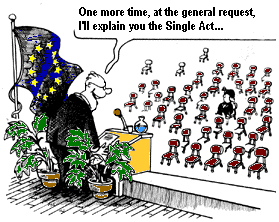"L'Europe, c'est aussi notre affaire !"
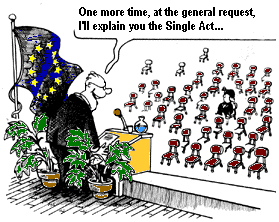
Une centaine de députés européens de toutes tendances ont lancé en juillet 1997 un SOS-Europe. Le constat qu'ils dressent de la situation économique, politique, institutionnelle et sociale de l'Union est alarmant mais terriblement juste.
Effectivement, l'Union européenne est confrontée, plus que jamais à la fin de ce siècle et à l'orée d'un nouveau millénaire à des enjeux considérables dans l'ensemble des domaines de la vie quotidienne. Si l'Union Economique et Monétaire (UEM) est maintenant assurée, jamais la population n'a dit "oui" à Maastricht et à l'Euro uniquement pour la beauté du symbole.
Les efforts demandés pour y parvenir sont extrêmement douloureux. Or, il est impératif de garder à l'esprit qu'ils ne sont acceptés que dans la perspective d'une amélioration rapide de la situation économique et sociale. C'est pourquoi, l'Euro doit naturellement être une monnaie qui inspire confiance. Mais il doit également avoir des marges suffisantes pour permettre l'adoption d'une politique sociale européenne volontariste. Une politique qui donne tout son sens à l'économie sociale de marché et au modèle social européen, autrement qu'en favorisant la concurrence et le secteur privé, là où il y a aujourd'hui service public.
Ensuite, il est urgent de se rendre compte que l'ouverture des négociations d'adhésion des Pays de l'Europe Centrale et Orientale (PECO) lors du Conseil européen de Luxembourg représente l'un des enjeux les plus formidables de notre temps. Il s'agit ni plus moins que d'amorcer la réconciliation du continent avec lui-même. Mais là encore, il convient de prendre la mesure des bouleversements que cela va induire dans l'architecture globale de l'UE et de ses politiques. Aucun des mécanismes de décision et de péréquation de l'Union ne pourra rester en l'état sous peine d'explosion tant les pressions seront fortes. Car l'élargissement à des pays tels que la Pologne ou la République tchèque implique une réforme de la politique agricole commune (PAC) et des fonds structurels et régionaux. L'Agenda 2000 présente par Jacques Santer au Parlement européen le 15 juillet dernier, trace le contour des principaux problèmes auxquels seront confrontés non seulement les 11 pays candidats à l'adhésion mais également les Etats membres actuels. Réussir l'élargissement, c'est mesurer le coût que cela va représenter, en tenir compte et, en même temps, ne pas se laisser arrêter par un tel argument. Car il est évident que le prochain élargissement diffère complètement des précédents, tant par le nombre de candidats bien sûr, que par le niveau économique, politique et social atteint par ceux-ci.
Aussi, il est tout aussi évident qu'il aura un coût. Par ailleurs, il serait étonnant que celui-ci reste dans la limite que s'est fixée la Commission de 1,27% du PIB de l'UE. Avec 75 milliards d'Ecus mobilisés, le "Plan Marshall pour les PECO" est encore loin des efforts fournis par les Etats-Unis pour le redressement de l'Europe occidentale au sortir de la dernière Guerre mondiale. John Eatwell et le Forum Européen pour la Démocratie et la Solidarité ont raison de pointer du doigt nos carences dans l'affaire. «Trade, not aid» nous disent les responsables politiques des PECO. Sachons leur ouvrir nos marchés, ce sera la meilleure aide que nous puissions leur fournir. Sachons aussi les associer véritablement au processus de négociation de leur adhésion.
Mais plus largement, l'élargissement pose aussi la question de la réforme institutionnelle. A Amsterdam, les gouvernements n'ont pas su y répondre. Ce faisant, ils se sont disqualifiés pour longtemps auprés de l'opinion publique car, il ne suffit pas de prendre des engagements, encore faut-il avoir la rigueur de les tenir. Les 15 gouvernements n'ont pas su ou voulu le faire. Pour cela, on est fondé à dire que les conclusions d'Amsterdam auront été devant l'Histoire, le révélateur des égoïsmes nationaux. De ces égoïsmes qui rendent toute politique étrangère et de sécurité commune (PESC) impossible. L'incapacité répétée du Conseil à prendre une décision devant les drames qui ont frappé ces dernières années la Bosnie-Herzégovine, la Tchétchénie ou encore l'Afrique des Grands Lacs en est le dramatique témoignage.
Hésitante à 15, quand elle décide à l'unanimité sur un mode intergouvernemental, qu'en sera-t-il lorsque l'Union européenne comptera une trentaine de membres ? L'Europe politique ne peut s'offrir le luxe d'un tel risque.
Pour notre part, nous voulons une Europe plus humaine, plus démocratique, plus solidaire et plus unie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les eurosceptiques sont loin d'être les seuls à pouvoir donner de la voix. Les responsables politiques de chacun des Etats membres et particulièrement les députés européens doivent savoir que le temps heureux des déclarations d'intention qui n'aboutissent jamais est un temps révolu. A ce titre, l'article 138 A du Traité de Maastricht, qui assigne aux partis européens le pouvoir d'exprimer la volonté politique des citoyens, doit être appliqué sans délai. Et alors que la Commission européenne a proposé la réunion d'une nouvelle CIG avant l'an 2000, une question nous taraude l'esprit : quels sont parmi les parlementaires, ceux qui auront un jour le cran politique de s'inviter à un Conseil européen et de n'en sortir qu'avec l'assurance de la convocation en juin 1999 d'une Assemblée investie d'un pouvoir constituant à l'occasion du renouvellement du Parlement européen ?
Car si l'Europe est votre mandat, elle est aussi notre affaire.
Aleksander GLOGOWSKI (USE, France), Nina HERGENROEDER (Allemagne), Nathalie LAFAURIE (Poitiers, France), Jörg LASCHET, Adjoint au maire d'Alfter (Grunen, Allemagne), Kathrin SWEENEY (Irlande)